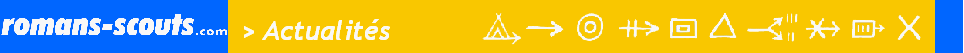|
Pour écrire de tels romans scouts, on suppose que l'auteur lui-même a été scout. Quel a été votre parcours ?
Comme mes parents ont déménagé plusieurs fois, j'ai été scout à différents endroits : à Strasbourg, à Paris, à Rennes et même scout marin à Toulon. Puis j'ai été assistant dans une troupe, chef de clan et enfin au service de mon mouvement comme rédacteur dans une revue et formateur des chefs. Après quoi le scoutisme m'a repris au collet : j'ai été aumônier à Lille puis à Paris. J'ai donc une jolie collection de foulards. Et de souvenirs…
Le scoutisme m'a donné quelques-unes des plus grandes joies de ma vie, mais aussi quelques-unes des plus grandes amertumes. Mon parcours n'a rien de linéaire ; il est plein de ruptures, de retours. Mes années de C. P. ont été très difficiles ! Depuis mon entrée aux louveteaux, je crois que le scoutisme m'a surtout donné à la fois l'idéal et le goût de la vérité. Mais ni l'idéal ni la vérité ne s'atteignent sans bagarre.
Lieux, personnages… Quelle est la part de vérité dans ces aventures ? Iaume, le héros, existe-t-il ? Et la Troupe 3e Ardres ? Ces deux grands jeux ont-ils vraiment eu lieu ?
Eh non, la 3e Ardres-d'Allèves (département de l'Ardentin), troupe de Sainte-Marie-au-Mont, n'existe pas. Ni Iaume, ni les autres personnages. Mais je ne les ai pas imaginés non plus, car je n'ai aucune imagination. Disons que ce sont les petits ou grands frères de scouts réels. Mais quelquefois, après avoir écrit les romans, je rencontre des scouts que je n'avais jamais vus, et je me dis : « C'est Bertrand ! C'est Tophe ! »
Si vous voulez en savoir plus sur Ardres et la 3e, fouillez dans mes papiers, car j'ai déjà beaucoup écrit sur cette ville qui n'existe pas. Ou, mieux : prenez une carte de France, tracez un cercle de cent kilomètres de diamètre entre Auvergne et Limousin, gommez tout le contenu du cercle et dessinez un département à votre guise avec Ardres au milieu. Et voilà !
En revanche, les lieux des deux romans existent. Ce sont les montagnes du sud du Massif central. Et les grands jeux qui y ont eu lieu sont ceux que j'y ai joués. « La part de vérité » dans un roman est toujours difficile à déterminer. J'aurais tendance à dire que si tout n'est pas arrivé tel quel, il n'y a pas de mensonge. De cela, je suis très fier : il n'y a pas de mensonge dans ces romans.
Y a-t-il un message pédagogique à tirer de ces romans ? Un chef scout peut-il tirer de ces deux romans des éléments pédagogiques, des idées ?
Soyons clair : un roman n'est pas un traité de pédagogie. Pour autant, le souci pédagogique ne me quitte jamais. Je crois qu'il y a autant d'éléments pédagogiques à tirer de ces romans qu'il y en a à observer des scouts réels dans leur vie scoute vraie.
Pour moi, il y a deux façons d'être pédagogue. L'une est d'arriver avec un programme d'adulte et de l'imposer : totalement inefficace et, à bien des égards, nuisible, si bonnes que soient les intentions. L'autre est d'essayer, autant que l'on peut, d'entrer dans la tête et le cœur des adolescents, d'en sentir les failles et l'énergie, et, par le jeu, le rire, la découverte, le silence, l'amitié, de les faire progresser. En regardant le monde par les yeux de Iaume, C. P. « de base », seize ou dix-sept ans, je me dépouille partiellement de mon expérience de chef, d'adulte, de prêtre. J'y perds en souplesse de langage -- les adolescents sentent juste, mais expriment mal --, mais j'y gagne en acuité. Le monde est plus grand, les choses plus neuves, les sentiments plus aigus, les enjeux plus radicaux.
La pédagogie scoute est anglaise, c'est-à-dire pratique. La noblesse, l'amitié, le pardon et la foi s'apprennent, dans le scoutisme, par la pierre et le vent, le jeu, l'effort et l'éblouissement. Il ne s'agit pas d'apprendre moins, mais pas plus de l'apprendre autrement. Le travail de réflexion commence où le livre s'arrête : ce que Iaume a compris en le vivant, « la morale de cette histoire », c'est au chef et à l'aumônier de le dire, s'il faut le dire.
Dans ces deux romans, vous décrivez avec finesse la psychologie de Iaume, l'archétype de l'éclaireur de 16-17 ans. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que le « Royaume » que recherche Iaume ?
Iaume m'est plus familier qu'à vous parce que je le connais depuis dix ans, comme un frère. Mais comme mon frère, je ne le connais pas entièrement. Iaume n'est pas moi, je ne lui ressemble pas du tout, sinon par le mauvais caractère. Je serais plutôt Charles…
Iaume est à la fois fort et vulnérable, généreux et brutal, plein d'idéal et révolté. Il veut être plus grand qu'il n'est, mais ses élans retombent souvent. Il est terrien, les deux pieds sur la roche -- tellement terrien qu'il a facilement le vertige --, mais il ne rêve que de s'envoler.
Il a un modèle, Guil, son premier C. P. Tous les novices, à douze ans, admirent leur C. P. qui en a dix-sept et qui leur paraît un héros de bravoure, de talent, de compétence. Mais qui dit que Guil était, à son propre regard, ce héros ? Qu'il ne voyait pas, au contraire, ses propres faiblesses ? Pour un garçon de seize ou dix-sept ans, tout est possible, mais rien n'est facile. L'idéal se rapproche et se dérobe en même temps. On veut être un saint, mais le sang bouillonne et les mots se dérobent. Or cette perpétuelle contradiction, c'est la vérité même de la vie humaine. On est rarement plus vrai, plus authentique, qu'à dix-sept ans. Après, hélas, on devient assez fort pour mentir. Iaume ne ment jamais. Mes C. P. réels ne mentent jamais. Ou mal.
Dans les deux romans, Iaume dépasse ses limites physiques. Mais il dépasse surtout ses limites morales. Et au terme se trouvent ces moments si rares, si précieux : les moments où l'on dit la vérité. Il n'y en a pas tant dans nos vies. À ces moments souffle l'Esprit.
Quant au « Royaume », ce n'est rien d'autre que le bonheur. Le bonheur n'est ni un lieu ni un moment, et pourtant nos mémoires lui associent moments et lieux. Sa porte est difficile à trouver : elle est au bout de la foi et de l'amitié. Et c'est le même Royaume, vous l'aurez compris, que le Royaume de Dieu. Toujours promis, souvent pressenti, parfois ouvert sur cette terre. Cela, Iaume ne saurait encore le dire clairement. Il en a reçu la promesse en prononçant sa Promesse, car toute promesse faite devant Dieu est réciproque. Il le devine, son cœur l'attend, il nomme cela : « le Royaume », sans précision, et il cherche… Comme nous tous.
Le vocabulaire des éclaireurs est parfois « fleuri ». N'est-ce pas gênant ?
Les manuscrits ont été écrits en « version originale ». Je crois que tout mon vocabulaire de gros mots y passait. Mais il n'était pas question de publier les romans tels quels. J'ai donc traqué le gros mot !
Cela dit, il existe une rhétorique et un phrasé scouts, dans la bagarre comme dans l'amitié. Je me suis bien amusé à les reconstituer ; j'espère que le lecteur s'amusera à les lire.
On sent aussi une grande expérience dans les grands jeux : intrigue, enchaînement, thème imaginaire… Il y a notamment quelques scènes mémorables pendant lesquelles les éclaireurs s'affrontent, voire se « tapent dessus », même si cela reste dans le cadre du jeu scout, avec des règles. Mais à certains moments, on ne sait plus très bien si c'est du jeu… Ne craignez-vous pas qu'on vous le reproche ?
Pour qu'un grand jeu marche, il faut qu'il « morde » ; pour qu'il morde, c'est-à-dire pour qu'il y ait de l'enjeu, il faut que la frontière du jeu et du réel se brouille. Le but du jeu scout est précisément que réalité et fiction se marient de sorte que la réalité soit modifiée au terme du jeu. Un bon jeu est très difficile à monter, il demande beaucoup d'efforts aux chefs, même si les chefs eux-mêmes ne jouent pas.
Les garçons qui jouent se battent souvent. Boys will be boys, disait philosophiquement Baden-Powell, les garçons sont toujours des garçons. Le garde-fou du jeu est le fair-play, c'est-à-dire qu'on se bat franchement, mais non méchamment. Mes scouts se battent comme des joueurs de rugby : ils ne font pas semblant, mais quand un garçon est à terre, son adversaire le relève. C'est ce que Pierre-Louis Gérin nommait « le beau jeu ».
Mis à part les chefs, très peu présents, les adultes sont quasiment absents du roman. À peine croise-t-on deux ou trois fois une petite vieille au détour d'un village désert. Les adultes n'ont-ils pas leur place dans le « Royaume » ?
Si, mais pas en grand jeu. Il ne faut pas oublier que les deux romans n'occupent que trois ou quatre jours dans les trois semaines du camp.
L'idée de génie de Baden-Powell était justement de créer une « bulle » à la taille des adolescents, où ils peuvent se déployer sans l'ombre des adultes, comme de jeunes arbres dans une forêt ne peuvent se déployer que si des arbres plus hauts ne leur font pas d'ombre. Cette « bulle » n'est pas appelée à durer : tout camp a une fin, et l'âge éclaireur lui-même ne va pas au-delà de dix-sept ans. Au-delà, la présence des adultes est indispensable.
Les adultes ne sont pas exclus du « Royaume ». Ils sont dans le « Royaume » pour autant qu'ils le cherchent eux-mêmes : qu'ils espèrent, qu'ils avancent vers quelque chose. Iaume le sent chez la femme du presbytère et le pressent chez d'autres.
En écrivant ces romans, aviez-vous un but, un objectif ?
Chercher le « Royaume ». Et le faire partager.
Comment écrivez-vous ? En un jet ? Par petits bouts ? Le soir ? En journée…
Un roman sort en trois semaines de travail du matin au soir. Je sais que cela peut paraître rapide, mais j'ai toujours fait comme ça ! Ce qui demande, naturellement, que je ne fasse presque rien d'autre. Et tant pis pour les autres devoirs, ils attendent. Quand j'ai écrit le mot de la fin, le roman est tout geignant, tout fragile, tout fripé comme un bébé qui vient de naître, mais enfin, il est vivant. Suivent un à dix ans de relectures par petits bouts, de corrections innombrables, car je suis plutôt perfectionniste. Par phases : car il faut que je sois « dedans », dans l'ambiance, dans le décor. Certaines fois j'y suis, d'autres pas du tout. Pour moi, un roman n'est jamais fini. Le corriger, c'est retourner vivre dedans, le faire revivre. La publication est une décision redoutable, puisqu'il faut, là, qu'il soit fini.
Avez-vous eu des contacts avec Bernard Dufossé pour l'illustration du roman ? Comment avez-vous travaillé ensemble ?
Par téléphone, car Bernard Dufossé est à Hyères et moi à Paris. Mais nous nous sommes de suite entendus. Je connaissais Bernard par ses illustrations pour les Scouts de France, je mesurais donc son talent et son professionnalisme. Bernard a plongé dans les romans et dès notre premier contact, je me suis rendu compte qu'il les connaissait mieux que moi-même ! Il avait toutes les scènes en tête. Il les comprenait de l'intérieur : il a lui-même été scout et chef, il a vécu tout cela. Nous avons pris de longues heures pour les visages, les insignes, les paysages. Je suis émerveillé de la façon qu'il a eu de « voir » ce que j'avais écrit. J'ai gardé ses esquisses avec soin. Trouver quelqu'un qui raconte votre propre histoire par d'autres moyens que les vôtres est une expérience étonnante ; je recommande cette expérience à tous les romanciers.
Ces deux romans se situent dans la lignée de ceux de la collection « Signe de Piste ». En avez-vous lu ? Quels sont ceux qui vous ont marqué ? Quels auteurs préférez-vous ?
Je me souviens très précisément de mon premier « Signe de Piste » et des circonstances où il me fut offert. Je l'ai lu trois fois de suite, la dernière clandestinement, car mes parents s'inquiétaient ! C'était un Dalens, j'avais onze ans, il fut pour moi une révélation. Quelques semaines après, j'essayais d'organiser ma sizaine comme une patrouille… J'ai cependant eu peu de « Signe de Piste » comme adolescent, et encore ceux que nous avions étaient-ils à mon frère. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert des titres remarquables, des auteurs mal connus. S'il faut des titres, je dirais La tache de vin, de Dalens, La bande des Ayacks, de Foncine, Les galapiats de la rue Haute, de Fondal, et ceux de Valbert. S'il faut des auteurs, je crois que Jean d'Izieu et X.-B. Leprince s'imposent. Signé Catherine, de d'Izieu, qui est un « Rubans noirs », est le plus beau roman qu'on puisse lire à dix-huit ans. Rarement la collection a atteint une telle vérité, une telle hauteur, une telle simplicité.
Propos recueillis par Éric Bargibant
|
|